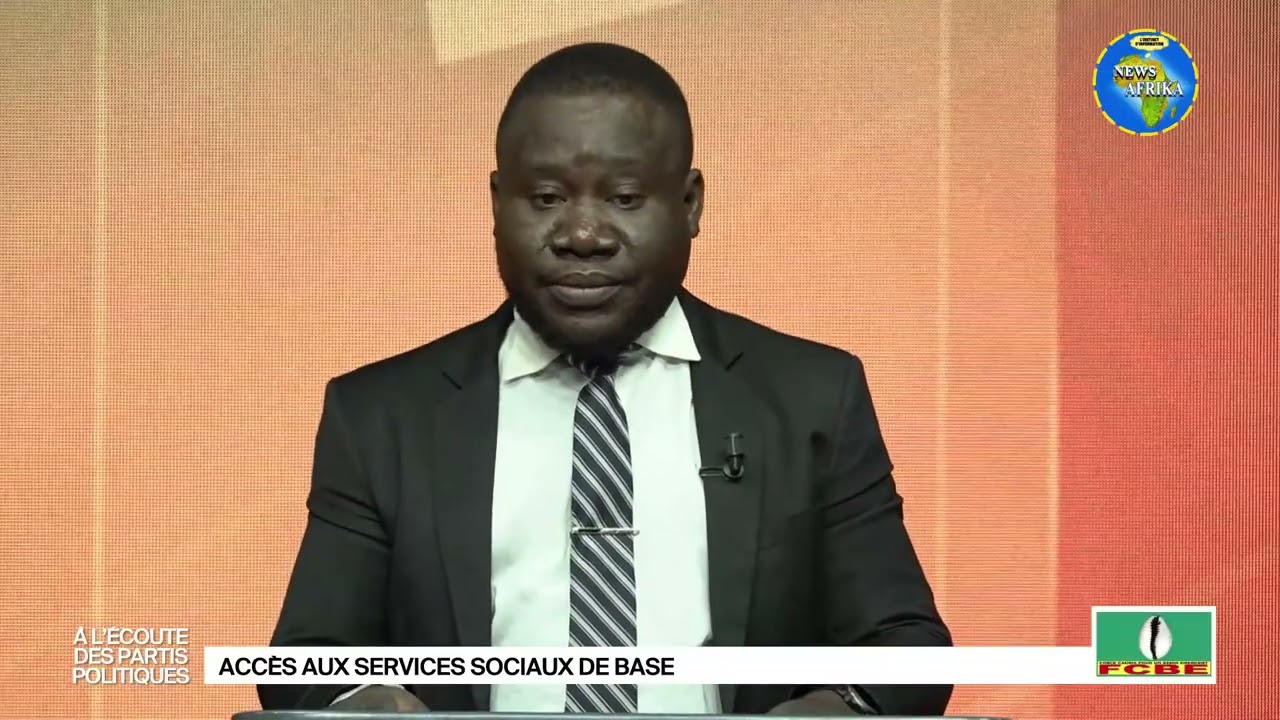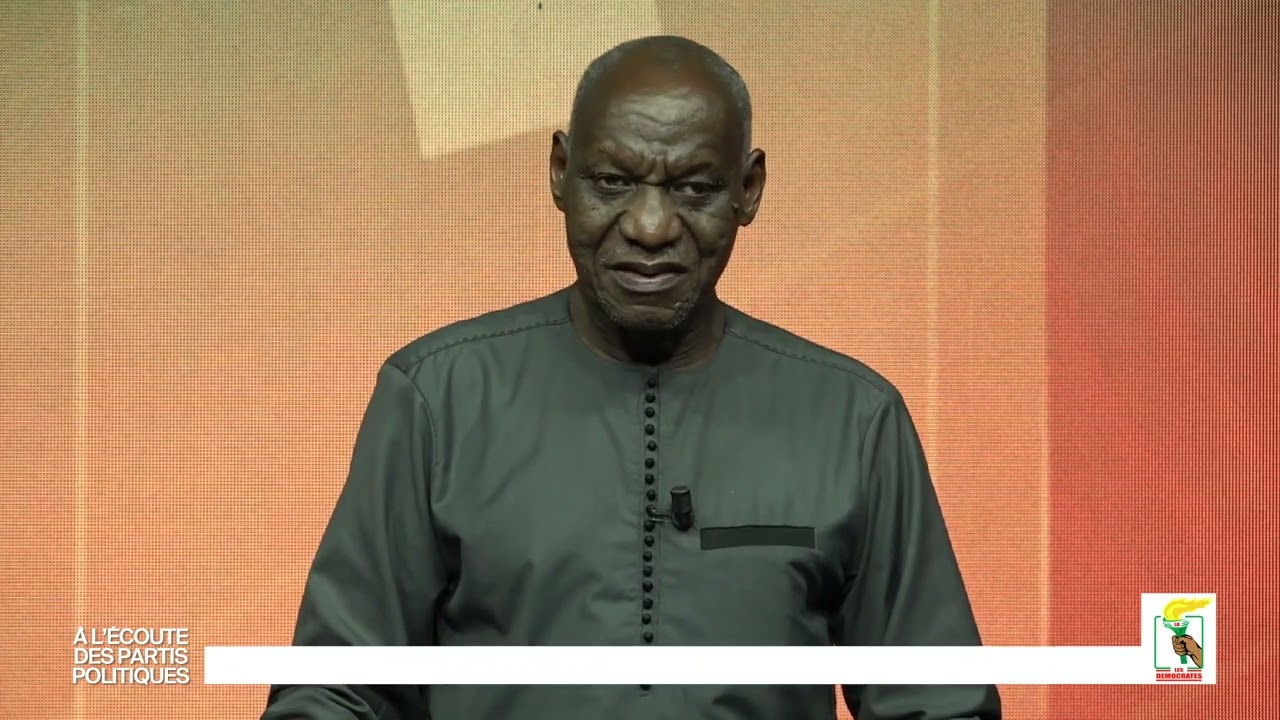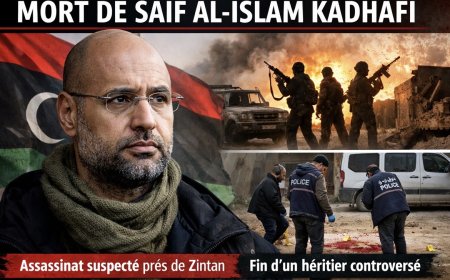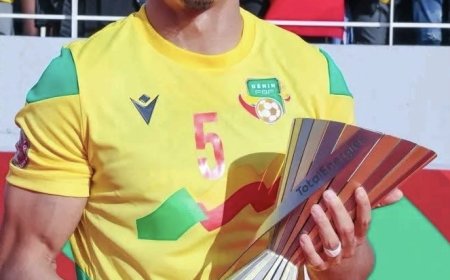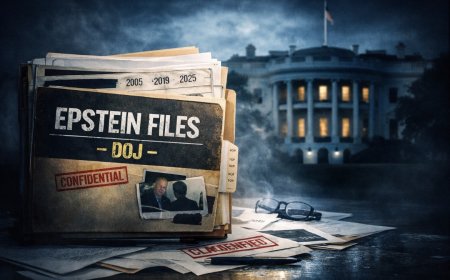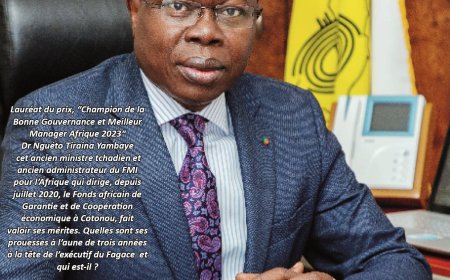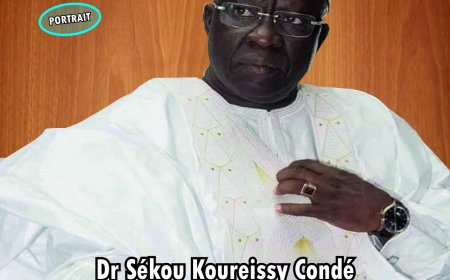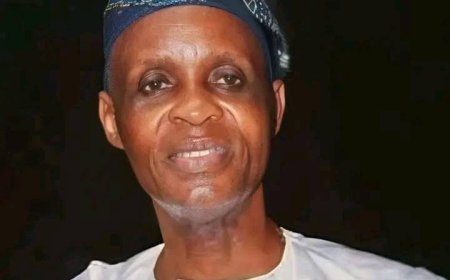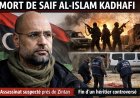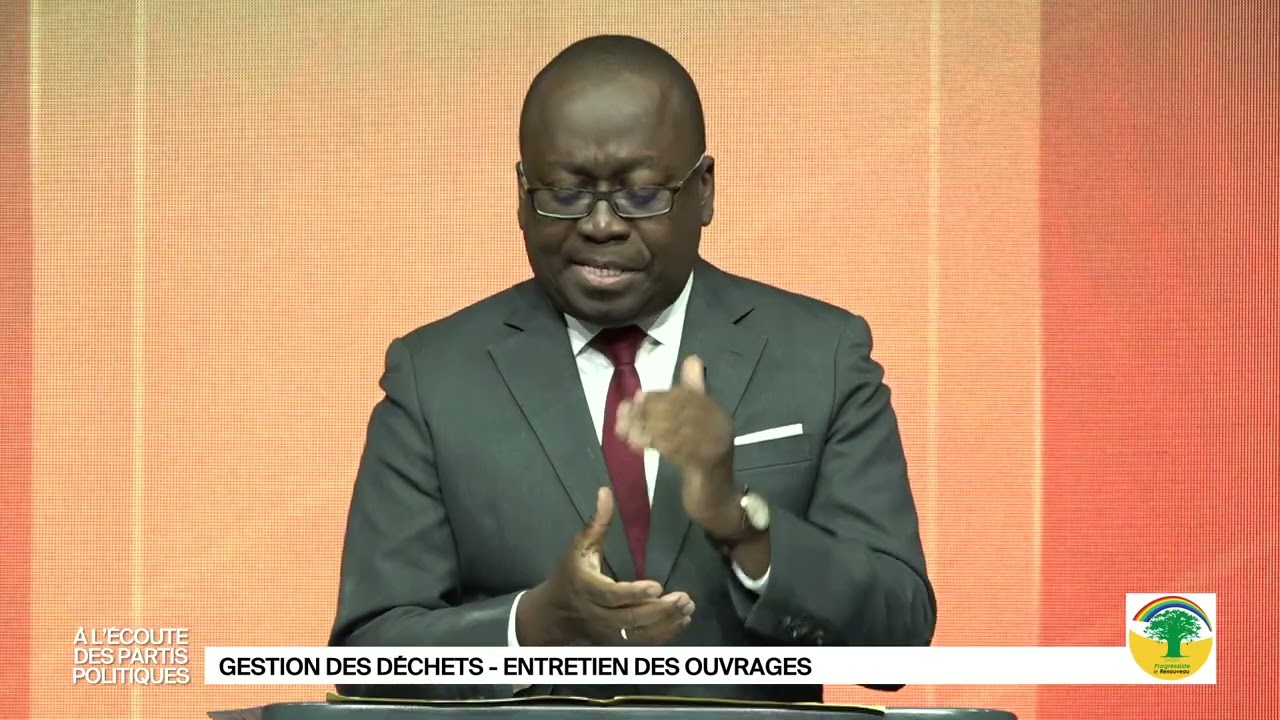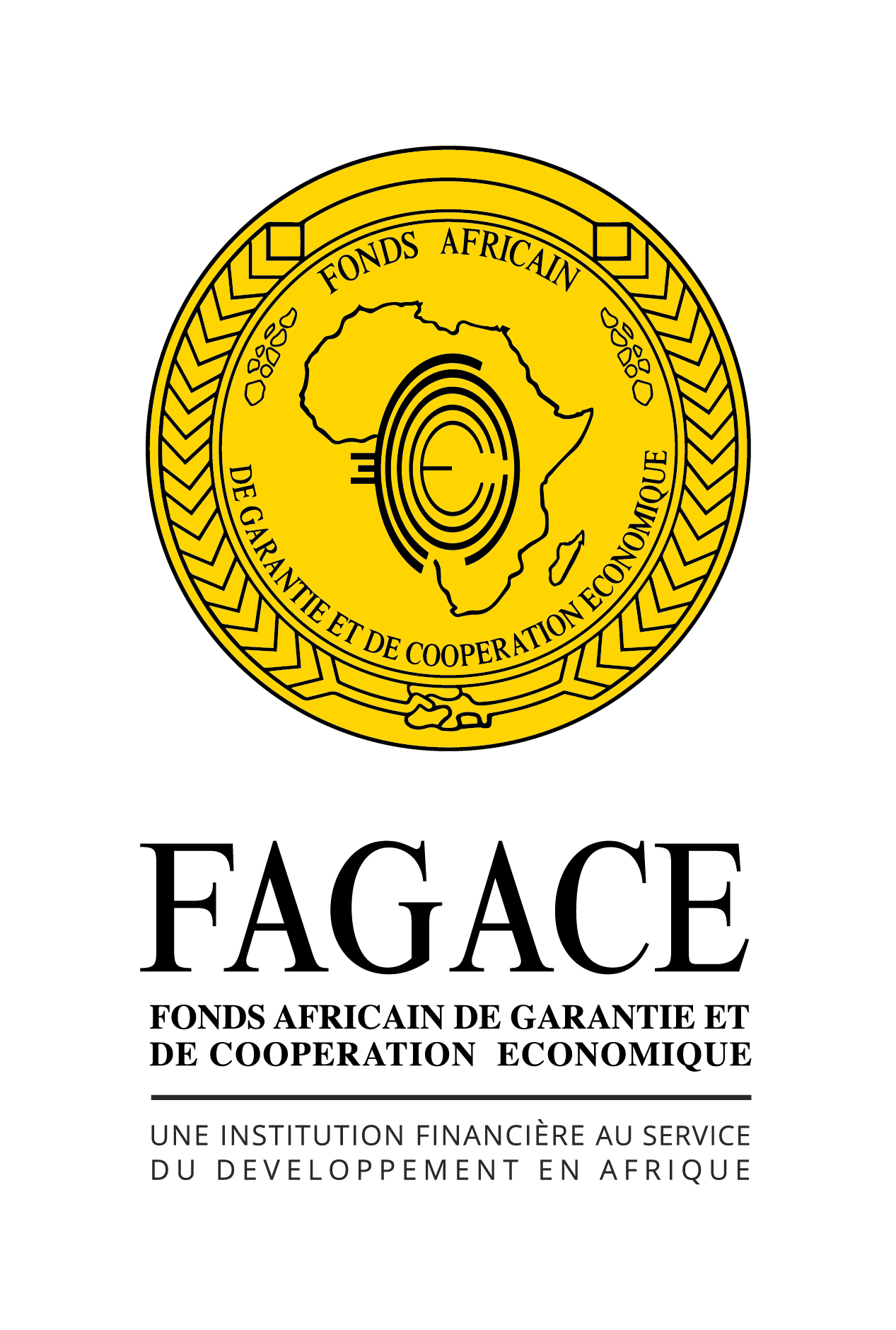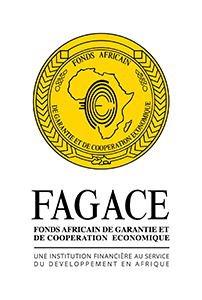Entre Washington et Caracas, la méfiance n’est pas nouvelle. Depuis l’arrivée d’Hugo Chávez au pouvoir en 1999, le Venezuela s’est progressivement détaché de l’influence américaine pour s’ériger en porte-étendard du socialisme latino-américain. L’ex-chef d’État, farouchement anti-impérialiste, dénonçait régulièrement les « ingérences » de Washington dans les affaires de la région.
Une relation empoisonnée depuis plus de deux décennies
À sa suite, Nicolás Maduro a poursuivi la même ligne, consolidant des alliances avec la Russie, la Chine et l’Iran, tout en accusant les États-Unis de vouloir provoquer un changement de régime.
En réaction, Washington a imposé une série de sanctions économiques et financières d’une ampleur inédite : gel d’avoirs, embargo sur le pétrole, et restrictions commerciales visant directement le cœur de l’économie vénézuélienne.
La rupture diplomatique s’est consommée en 2019, lorsque les États-Unis ont reconnu Juan Guaidó comme président par intérim, rejetant la légitimité du pouvoir de Maduro. Depuis, l’ambassade américaine à Caracas est fermée, et les échanges officiels se limitent à quelques négociations humanitaires ponctuelles.
2025 : Washington relance la pression
Après quelques années de relative accalmie, l’année 2025 marque un tournant.
Sous la présidence de Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, les États-Unis ont décidé de reprendre une politique d’hostilité frontale contre le régime de Maduro, en justifiant leurs actions par la lutte contre les “narco-réseaux” opérant depuis les eaux vénézuéliennes.
Selon plusieurs sources, des frappes américaines ont été menées depuis le début de l’année contre des embarcations identifiées comme “liées au trafic de drogue”.
Ces opérations auraient déjà causé plus d’une trentaine de morts, principalement dans les eaux du sud de la mer des Caraïbes.
Washington invoque un cadre juridique flou de “conflit non international” contre des groupes criminels transnationaux, tandis que Caracas dénonce des attaques illégales et un acte de guerre déguisé.
En parallèle, le président Trump a autorisé la CIA à conduire des opérations clandestines au Venezuela. L’information, confirmée par l’agence Reuters, constitue une escalade majeure, rappelant les heures sombres de l’interventionnisme américain en Amérique latine.
Une démonstration de force dans les Caraïbes
Ces dernières semaines, la présence militaire américaine s’est considérablement renforcée dans la région :
• déploiement de bombardiers B-52,
• mobilisation de navires de guerre, de sous-marins et de marines,
• manœuvres coordonnées au large du Venezuela.
Officiellement, il s’agit d’une opération anti-trafic de stupéfiants, mais pour de nombreux observateurs, cette démonstration de puissance traduit un avertissement direct adressé à Maduro.
En réaction, le Venezuela a mobilisé ses forces armées et la Milicia Bolivariana, milice populaire créée pour défendre la “révolution bolivarienne” en cas d’agression étrangère.
Dans un discours télévisé, Nicolás Maduro a promis de “transformer chaque rue, chaque colline et chaque maison en champ de bataille” si une intervention américaine venait à se produire.
Les autres fronts du conflit : économie, diplomatie et migration
Sur le plan économique, Washington a révoqué la licence d’exploitation de Chevron, dernière grande compagnie pétrolière américaine encore autorisée à opérer au Venezuela.
Cette décision, saluée par les faucons républicains, risque toutefois d’aggraver une crise énergétique mondiale déjà tendue et d’asphyxier davantage l’économie vénézuélienne, dépendante à plus de 90 % des exportations de brut.
Par ailleurs, les États-Unis ont mis fin au statut de protection temporaire (TPS) accordé à quelque 270 000 Vénézuéliens vivant sur leur territoire.
En contrepartie, un accord bilatéral de rapatriement a été signé en mars, permettant la reconduite de migrants vers Caracas.
Malgré cette hostilité, des échanges de prisonniers ont eu lieu en 2025, preuve que les deux capitales maintiennent encore un fil diplomatique ténu.
Une crise aux implications géopolitiques majeures
Derrière ce bras de fer se joue bien plus qu’un différend bilatéral.
Les États-Unis entendent réaffirmer leur influence en Amérique latine, une région que la Russie et la Chine convoitent de plus en plus, notamment pour ses ressources pétrolières et minières.
Pour Washington, le Venezuela reste une porte d’entrée stratégique vers les Caraïbes et l’Atlantique Sud.
Pour Caracas, il s’agit de préserver sa souveraineté et de résister à ce qu’elle considère comme une tentative de recolonisation déguisée.
Cependant, plusieurs voix au sein même des États-Unis s’inquiètent de la légalité des opérations menées sans autorisation du Congrès ni mandat international.
Des juristes rappellent que le droit international interdit toute action armée sur un territoire souverain sans résolution du Conseil de sécurité ou sans menace directe avérée.
Certains parlent déjà d’un “Irak latino-américain” en gestation.
. Entre guerre larvée et impasse diplomatique
À ce jour, aucun signe d’apaisement n’est perceptible.
Washington campe sur sa position : “éradiquer les cartels qui déstabilisent la région”, tandis que Caracas dénonce une “guerre impérialiste”.
Dans les rues de Caracas, la tension monte ; la population, déjà épuisée par l’inflation et les pénuries, craint de replonger dans une nouvelle décennie de chaos.
Les chancelleries européennes appellent à la désescalade et à un dialogue sous médiation internationale, mais ni Trump ni Maduro ne semblent prêts à céder.
Le Venezuela, soutenu par Moscou et Téhéran, pourrait même chercher à internationaliser le conflit, tandis que les États-Unis multiplient les alliances régionales pour isoler davantage le régime chaviste.
L’histoire entre les États-Unis et le Venezuela est celle d’un malentendu persistant entre deux visions du monde :
l’une, interventionniste et sécuritaire ; l’autre, souverainiste et révolutionnaire.
En 2025, cette rivalité prend un tournant potentiellement explosif, à un moment où la scène internationale est déjà saturée de crises.
Entre opérations secrètes, sanctions économiques et démonstrations militaires, le risque d’un affrontement direct n’a jamais semblé aussi réel depuis vingt ans.
Reste à savoir si la raison diplomatique finira par l’emporter sur la logique de confrontation.
Guy L CHAFFA