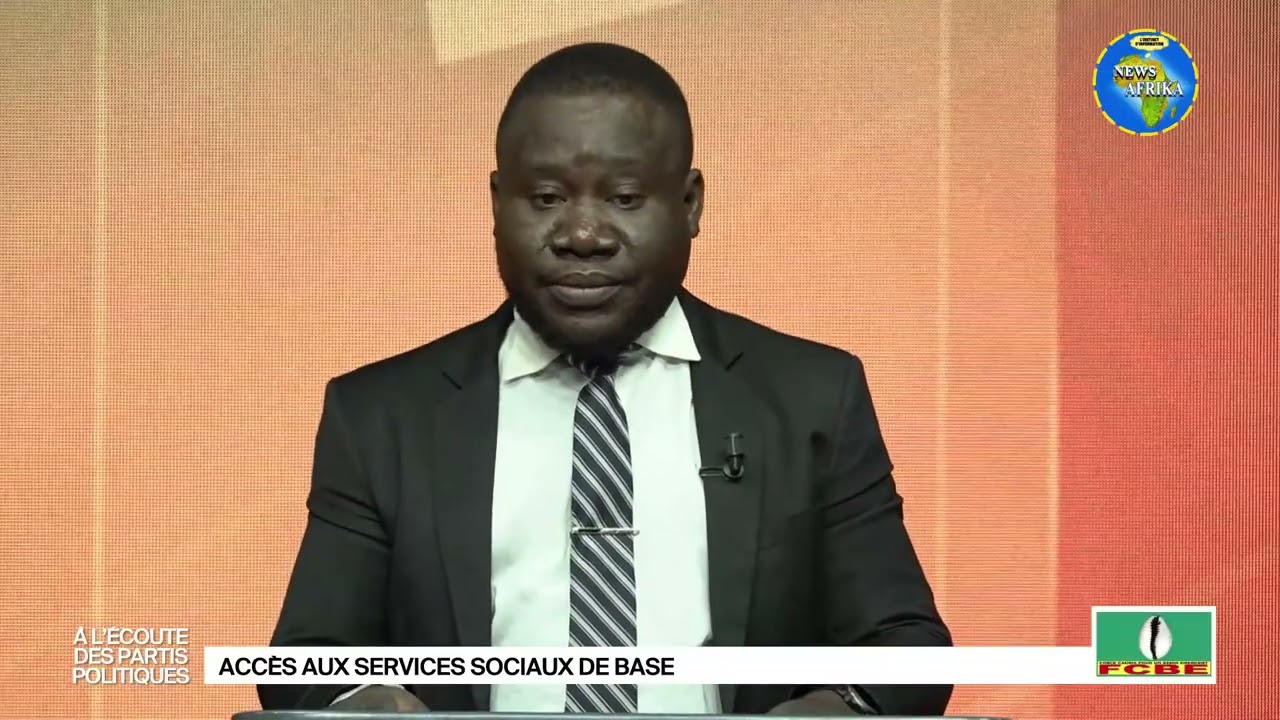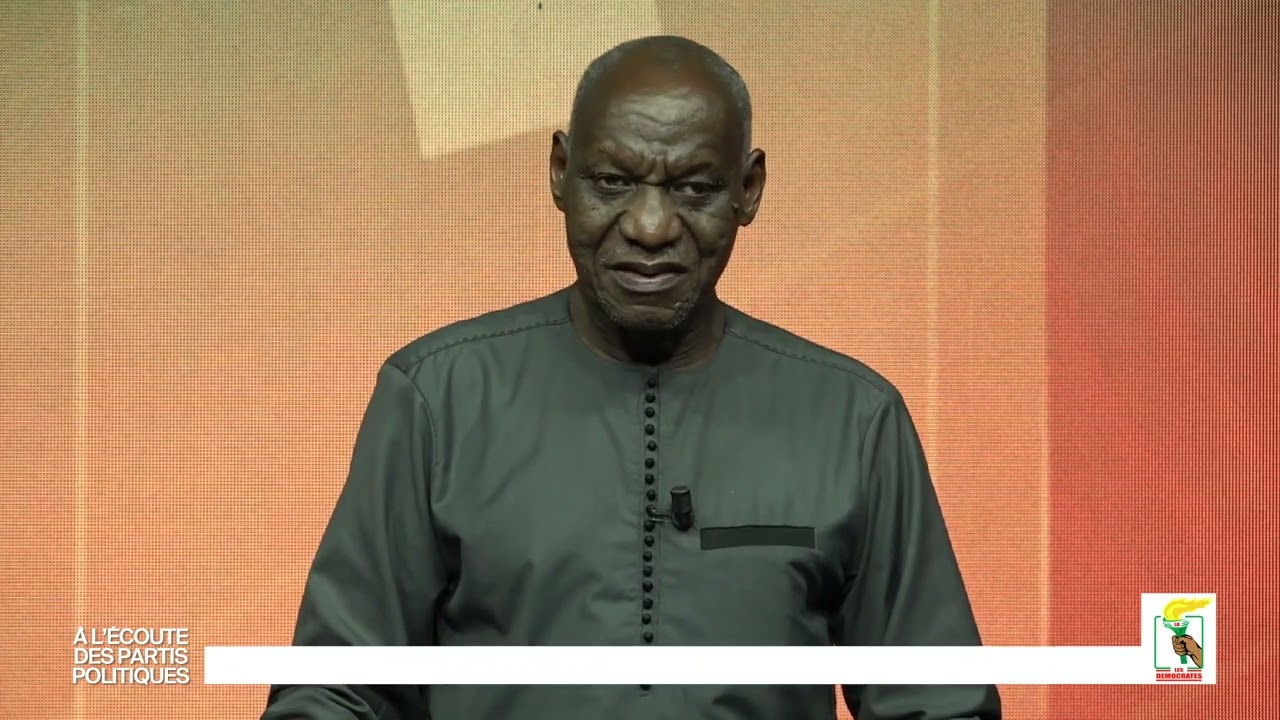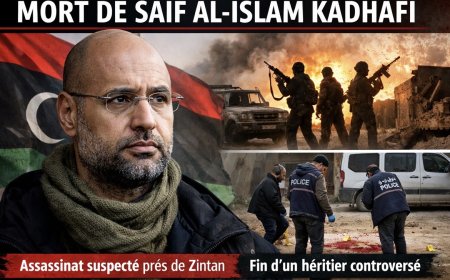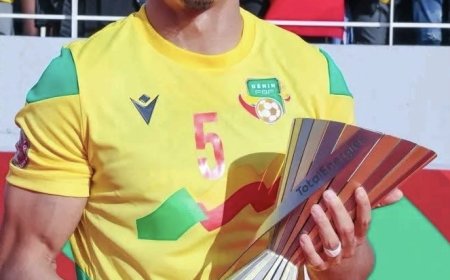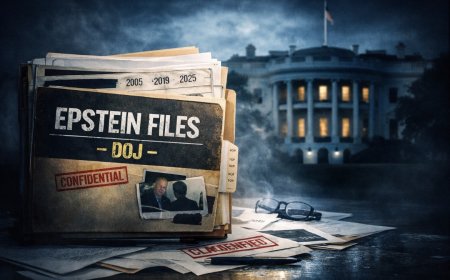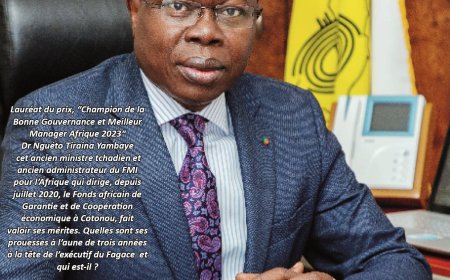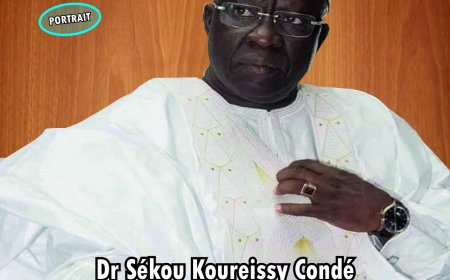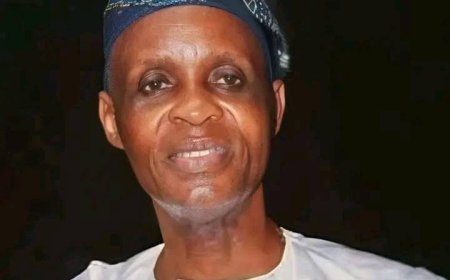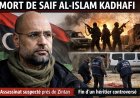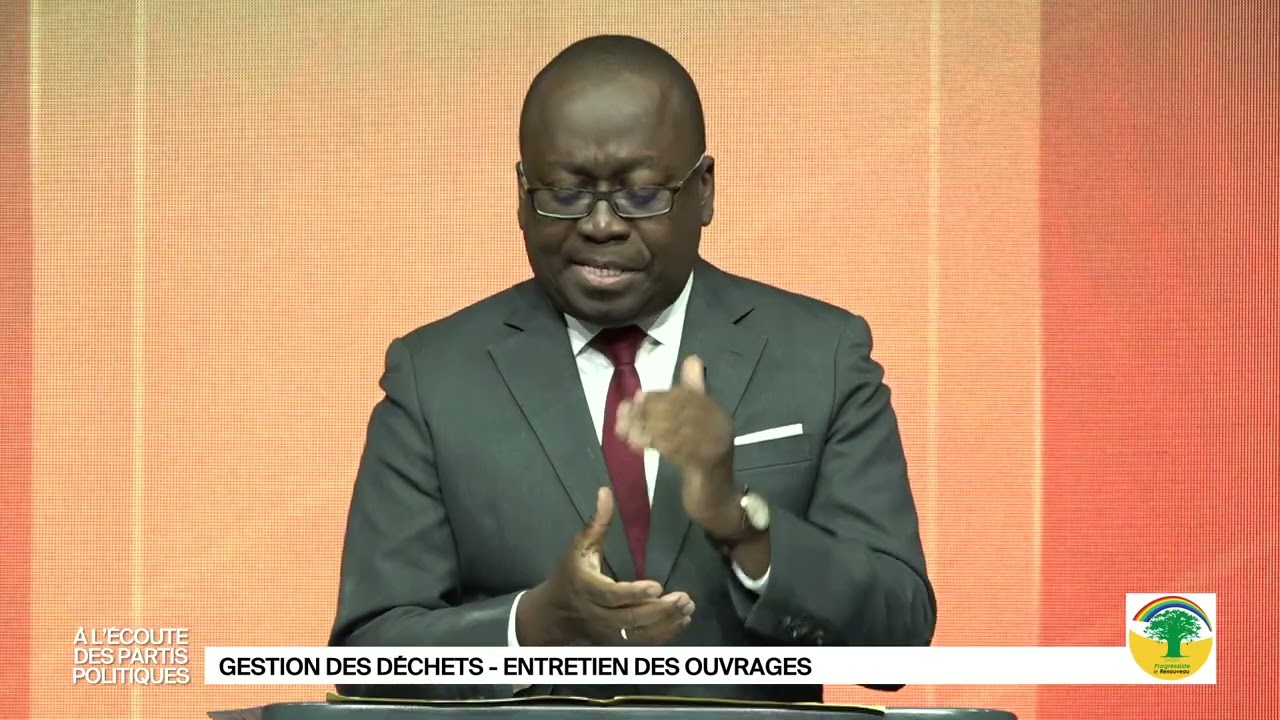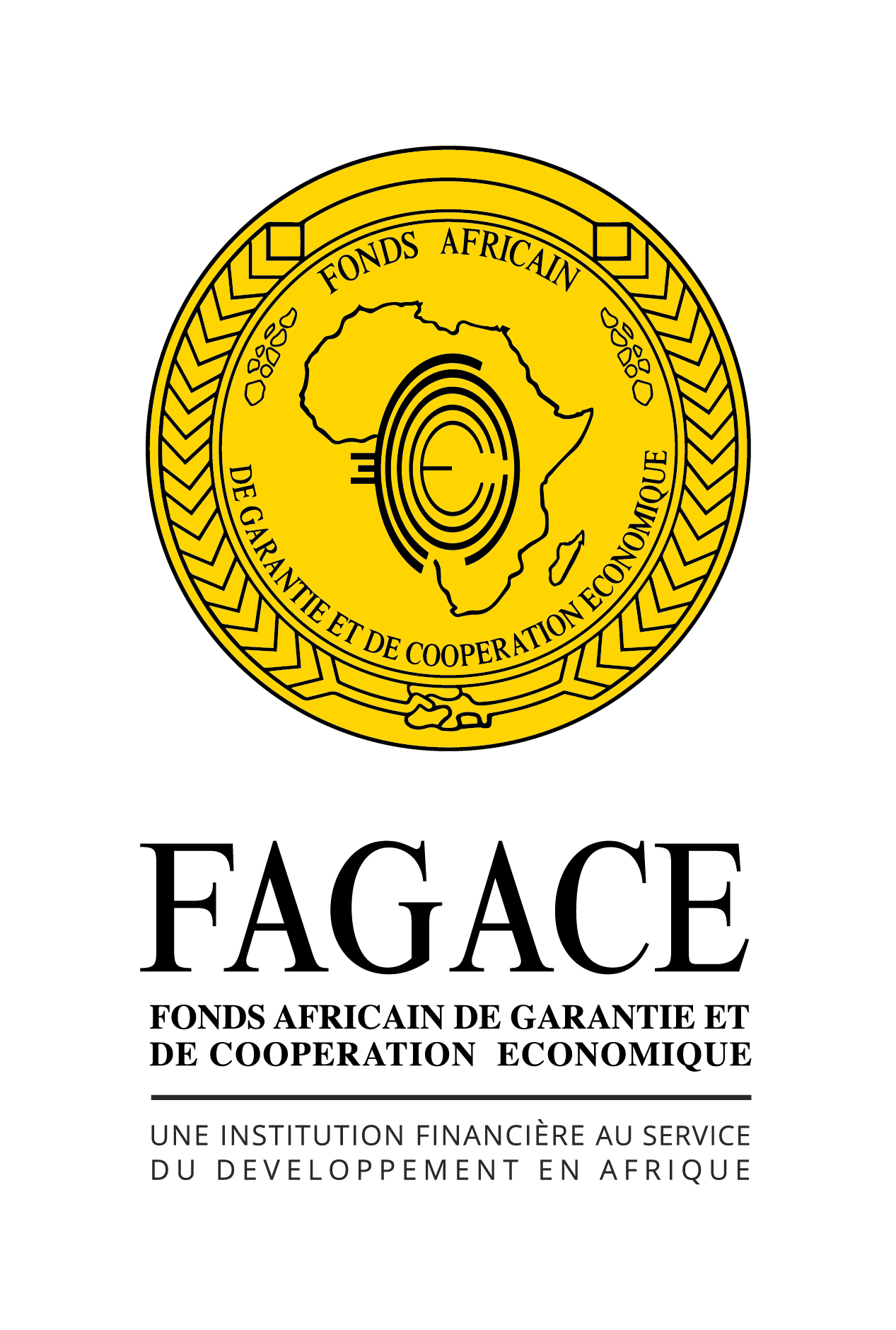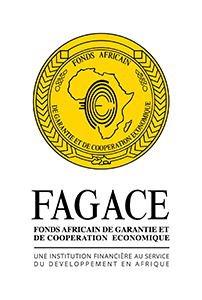Révision constitutionnelle au Bénin : le retour du bicaméralisme, ou la tentation d’un pouvoir des anciens
La perspective d’une nouvelle révision de la Constitution du 11 décembre 1990 refait surface à l’Assemblée nationale. Les initiateurs de la proposition, plusieurs députés de la majorité, souhaitent introduire une innovation majeure dans l’architecture institutionnelle du pays : la création d’un Sénat, composé d’anciens présidents de la République, d’anciens présidents d’institutions et de hauts gradés des forces armées. Derrière ce projet, apparemment inspiré par le souci de la stabilité et du consensus politique, se cachent pourtant des implications lourdes pour l’équilibre des pouvoirs, la démocratie et l’esprit de la Constitution béninoise.
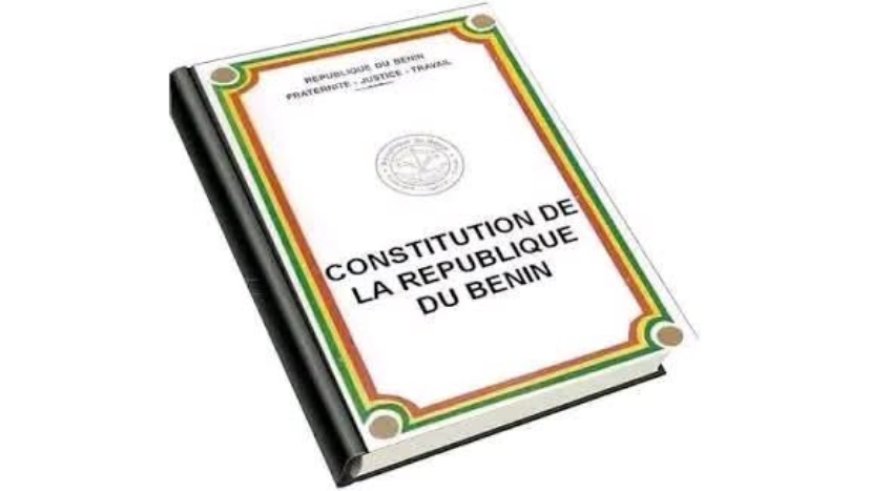
Une proposition qui change la nature du régime
Adoptée dans le sillage de la Conférence nationale de février 1990, la Constitution béninoise repose sur une logique claire : un régime présidentiel équilibré par des contre-pouvoirs institutionnels solides, en particulier la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. L’Assemblée nationale, unique chambre du Parlement, incarne la souveraineté populaire et assure, seule, la fonction législative.
Or, la création d’un Sénat – tel que formulé dans la proposition de loi – bouleverse cette architecture. Elle introduit une deuxième chambre parlementaire, composée de personnalités non élues, dotées de prérogatives d’avis et de relecture des lois, voire de pouvoir d’arbitrage politique. En d’autres termes, c’est une transformation du système monocaméral en un bicaméralisme hybride, où la légitimité électorale cède la place à la “sagesse institutionnelle”.
Un Sénat des anciens : conseil de sages ou chambre d’influence ?
Dans le texte soumis, le Sénat rassemblerait les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle, ainsi que d’anciens chefs d’état-major. À ces membres de droit s’ajouteraient des personnalités désignées par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale.
Présentée comme une chambre de “médiation politique” chargée de promouvoir l’unité nationale et la stabilité, cette structure risque de devenir un véritable pouvoir parallèle, sans légitimité populaire mais doté d’une influence considérable sur la conduite de l’État.
Le danger n’est pas tant dans la création d’un Sénat – que plusieurs démocraties connaissent – que dans sa composition et son statut : une chambre d’anciens dirigeants, non élus, désignés, où la mémoire politique se confond avec le pouvoir institutionnel. C’est une dérive oligarchique potentielle, contraire à l’esprit de la Conférence nationale qui, en 1990, avait précisément voulu rompre avec les structures de pouvoir fermées et cooptées.
Une révision aux conséquences systémiques
Sur le plan juridique, la création du Sénat impliquerait la réécriture complète du Titre IV de la Constitution (relatif au pouvoir législatif), l’introduction d’une procédure de navette entre les deux chambres et la redéfinition du processus législatif.
Mais surtout, cette innovation crée un déséquilibre fonctionnel : dans un régime présidentiel pur, comme celui du Bénin, la coexistence d’un Sénat doté d’un pouvoir d’avis ou de lecture définitive entraînerait une paralysie de la fonction législative ou, à terme, l’apparition d’un chef de gouvernement chargé d’assurer la coordination politique entre le Président, le Sénat et l’Assemblée nationale.
Autrement dit, le pays glisserait vers un régime semi-présidentiel, avec l’introduction quasi inévitable d’un Premier ministre. Ce serait une rupture majeure avec la philosophie constitutionnelle de 1990, qui a voulu un exécutif monocéphale – un Président responsable devant le peuple, non devant le Parlement.
Les risques démocratiques d’un tel basculement
Derrière le discours de stabilité et de continuité institutionnelle, cette révision porte un risque clair : la confiscation du pouvoir par une élite politique et institutionnelle.
Confier le pouvoir de relecture des lois et d’arbitrage politique à des anciens présidents, anciens chefs militaires ou proches du pouvoir actuel, c’est ériger une chambre du passé, qui pèserait sur l’avenir du pays.
Dans un contexte où la participation politique se réduit, où les institutions indépendantes subissent des tensions et où les révisions successives de la Constitution alimentent la méfiance populaire, une telle réforme pourrait accentuer la distance entre les gouvernants et les citoyens.
De plus, en substituant à la légitimité électorale une légitimité fondée sur “l’expérience”, le projet sape le principe fondamental de l’article 3 de la Constitution : la souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants élus.
Le Sénat, dans sa conception actuelle, ne serait pas une “seconde chambre du peuple”, mais un sanctuaire du pouvoir, un espace où se recyclent les anciens dirigeants, hors de tout contrôle démocratique.
La tentation de la révision permanente
Depuis 2016, les tentatives de révision constitutionnelle se sont multipliées, souvent au nom de “l’efficacité institutionnelle” ou du “développement durable”. Pourtant, chaque réforme grignote un peu plus l’esprit de 1990, celui d’une Constitution protectrice des libertés, garante de la limitation du pouvoir et de la séparation des fonctions.
Or, une Constitution n’est pas un outil politique au service d’une majorité. C’est un pacte national.
Toucher à son équilibre, c’est toucher à la confiance que le peuple accorde à ses institutions.
Le danger, aujourd’hui, n’est pas tant de créer un Sénat que de vider la démocratie béninoise de sa substance populaire, en érigeant des mécanismes institutionnels qui éloignent le citoyen du centre des décisions.
Entre mémoire et avenir, un choix de société
Le Bénin a bâti, depuis 1990, une réputation internationale d’exemplarité démocratique. La stabilité de ses institutions repose sur un équilibre subtil entre le pouvoir exécutif, le Parlement, la justice constitutionnelle et les libertés publiques.
Introduire un Sénat d’anciens présidents et d’anciens chefs militaires, c’est certes honorer la mémoire des dirigeants passés, mais c’est aussi institutionnaliser la nostalgie du pouvoir, au risque d’étouffer l’élan démocratique qui a fait la force de la nation.
Le vrai défi du Bénin n’est pas d’ajouter de nouvelles institutions, mais de faire vivre celles qui existent.
La stabilité d’un État ne se mesure pas à la multiplication des organes, mais à la confiance de son peuple dans la justice et la transparence de ses gouvernants.
La révision constitutionnelle ne doit pas être un outil d’héritage politique. Elle doit rester, comme en 1990, un acte fondateur du peuple souverain.
Par Oladélé
Quelle est votre réaction ?