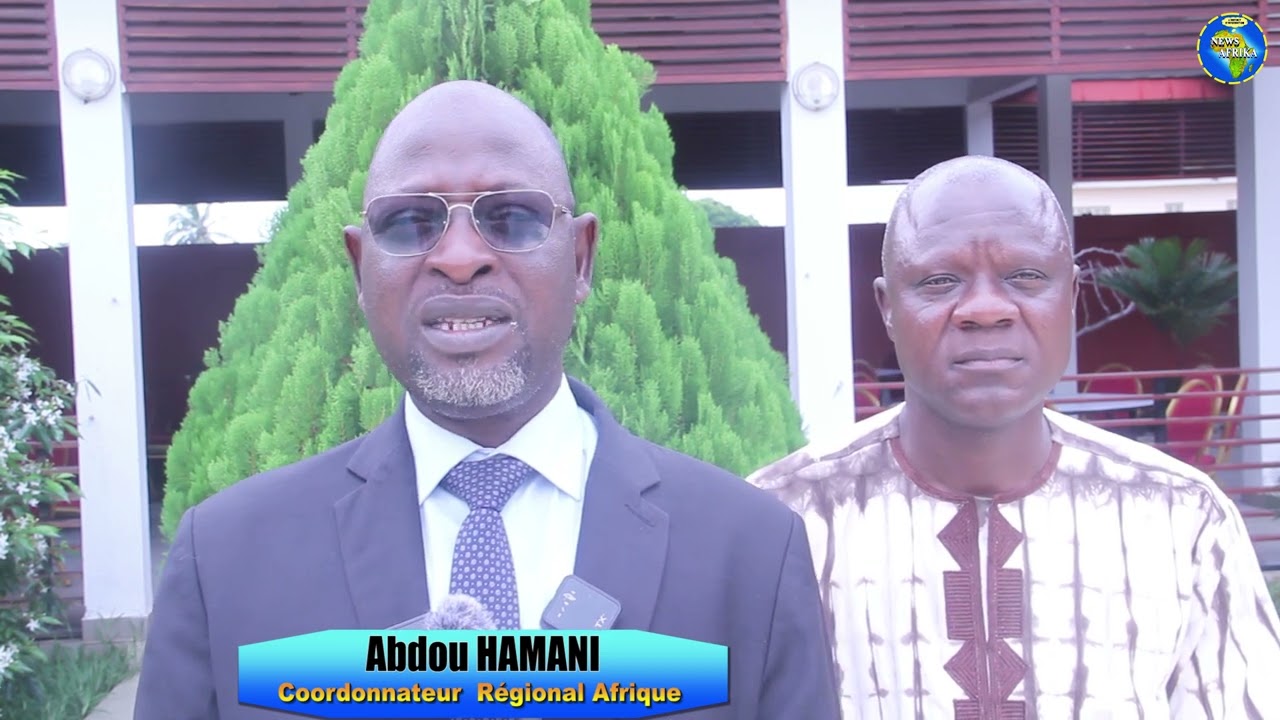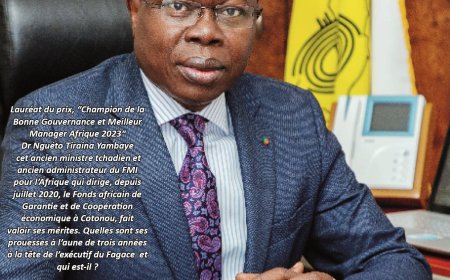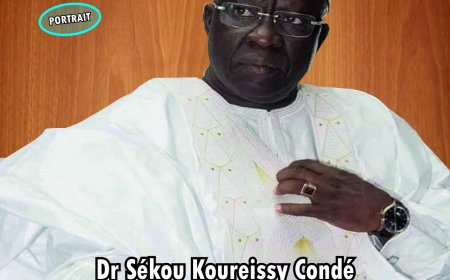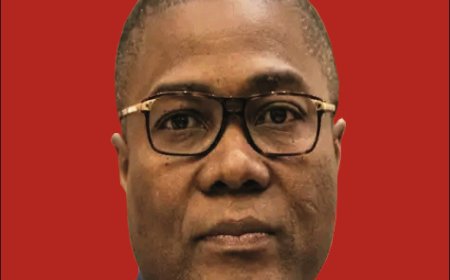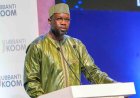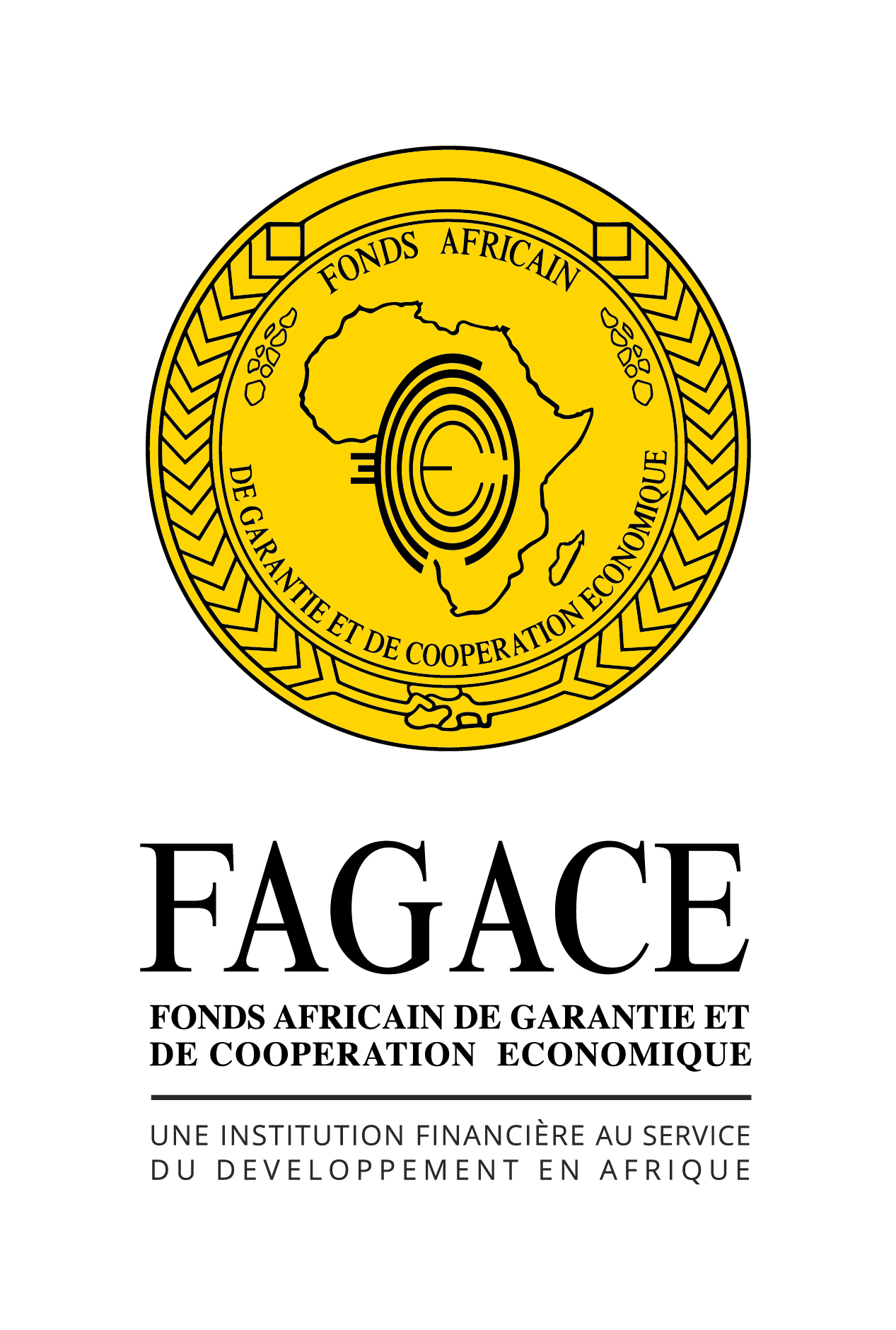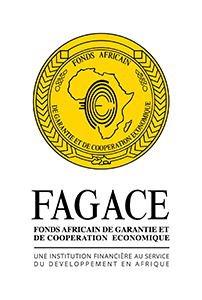Chronique — La démocratie sous blindés : quand le symbole dépasse le geste
Il y a des images qui pèsent plus lourd que les discours, des images qui disent tout d’un pays, d’un pouvoir et d’une époque. La venue de Mamadi Doumbouya à la Cour suprême, escorté d’une centaine de gardes et de blindés, fait désormais partie de celles-là. Elle restera, comme une photographie discordante, dans l’histoire politique récente de la Guinée.
Ce jour-là, la République n’a pas vu un candidat.
Elle a vu un pouvoir.
Et c’est bien là que réside l’aberration.
On raconte que la démocratie est un espace ouvert, fragile, mais confiant en ses propres règles. Ce à quoi nous avons assisté relève au contraire d’un théâtre martial : blindés, fusils, gilets, cortège serré… comme si l’acte simple et noble de déposer un dossier électoral menaçait la vie même du déposant ou bien devait impressionner la nation entière.
Il ne s’agit plus de protéger un homme ;
il s’agit de sacraliser son pouvoir.
Une candidature ainsi mise sous armure ne rassure pas : elle inquiète. Elle envoie le message qu’on ne veut pas jouer à armes égales, mais imposer une vérité par la force, par l’intimidation, par le spectacle des muscles. Et lorsque la politique descend sur ce terrain, c’est rarement la démocratie qui gagne.
On se souvient encore du discours solennel du chef de la junte, juste après le coup d’État :
“Je ne serai pas candidat.”
Trois ans plus tard, les blindés roulent vers la Cour suprême.
La Constitution a été remodelée.
Les institutions, recalibrées.
L’opposition, affaiblie.
Et la transition, promise comme une parenthèse, devient un tremplin.
Ce retournement n’est pas seulement un reniement :
c’est une rupture morale entre le pouvoir et la parole donnée.
La vérité, c’est que la population guinéenne est aujourd’hui divisée. Une partie acclame encore l’homme fort, y voyant un rempart contre l’instabilité, un restaurateur de l’autorité, un chef capable de dompter l’incertitude. Une autre y voit une confiscation progressive du destin national, une élection jouée d’avance, un avenir verrouillé par celui qui détient les armes.
Dans les rues, dans les marchés, dans les taxis, on parle, on murmure, on s’interroge :
“Si un candidat a besoin de tant d’armes, de quoi a-t-il peur ?”
“Et si c’est ainsi qu’on entre dans la campagne, comment en sortira-t-on ?”
La Guinée avait une occasion unique : prouver au monde qu’une transition militaire peut conduire à un renouveau démocratique sincère. Mais à mesure que l’échéance approche, ce qui s’impose n’est plus la volonté de rendre le pouvoir au peuple, mais celle de l’organiser autour d’un seul homme.
L’histoire africaine est pleine de ces trajectoires où le sauveur devient maître, où la transition devient installation, où la promesse devient justification. La Guinée mérite mieux que ce cycle répété qui finit toujours par coûter au peuple ce qu’il a de plus précieux : sa confiance.
En définitive, ce qui choque, ce n’est pas la candidature.
Ce n’est même pas l’ambition.
C’est le symbole.
Dans une démocratie apaisée, un candidat se rend à pied ou en voiture à la Cour suprême, saluant la foule, serrant des mains, dialoguant avec ses concitoyens.
En Guinée, ce jour-là, la démocratie n’a pas avancé à visage découvert.
Elle est arrivée sous escortes, protégée du peuple, coupée de la rue, enfermée dans un cortège de blindés.
Et lorsqu’une République en arrive là, ce n’est pas le peuple qui est protégé :
c’est le pouvoir qui se protège du peuple.
Oladélé
Quelle est votre réaction ?